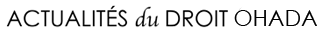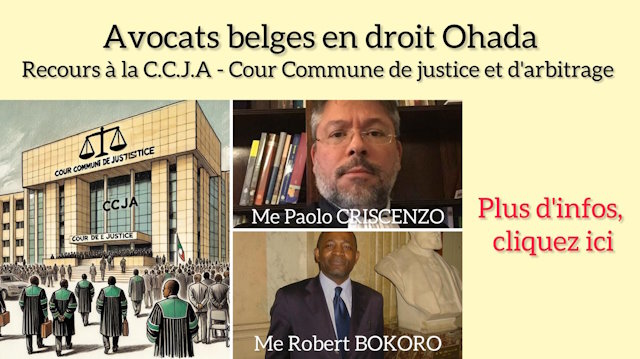Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) - Article 4 AUS – Article 14 AUS Révisé
Présentation des faits1
Le 8 décembre 2006, la Banque B. a consenti un prêt d'un montant de 65.168.824 francs CFA à son client Monsieur B.B.
Pour garantir le paiement dudit prêt, Monsieur B.B. a dû souscrire un billet à ordre du montant susmentionné.
En outre, Monsieur B. L., le père de Monsieur B.B., s'est constitué caution solidaire à son profit, en promettant en cas d’insolvabilité de grever, d'une hypothèque au profit de la BOA, son immeuble formant la parcelle D lot 362, situé à Kombougou.
A l’échéance, la BOA a présenté le billet à ordre, mais n’a pas obtenu paiement pour défaut de provision.
Estimant avoir suffisamment entrepris vainement des démarches pour un recouvrement amiable de sa créance, la BOA a initié une procédure d'injonction de payer et a bénéficié d'une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, n° 390/2004 du 12 août 2004, enjoignant à B.B. de lui payer la somme ci-dessus indiquée.
En exécution de ladite ordonnance, la BOA a seulement pu recouvrer la somme de 14.903.800 francs CFA sur le montant total.
La BOA, ayant poursuivi en vain le paiement du reliquat, a alors introduit une requête auprès du président du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso et a obtenu le 28 octobre 2006 une ordonnance n° 227/2006 l'autorisant à faire procéder à une inscription hypothécaire provisoire sur la parcelle D, lot 362.
Par exploit d'huissier en date du 07 novembre 2006, elle a assigné Monsieur B.L. devant le Tribunal de céans pour s'entendre déclarer valable l'hypothèque judiciaire.
Monsieur B. L. conclut à la nullité du cautionnement passé entre lui et la BOA, et par ricochet à la mainlevée totale de l’hypothèque judiciaire provisoire sur son immeuble.
Sur la nullité du cautionnement, il fait valoir que la BOA l'a rejoint dans ses bureaux pour lui faire apposer sa signature uniquement sur imprimé et lui réclamer le titre foncier n° 820 de la circonscription de Bobo-Dioulasso, en lui faisant croire que c’était pour faciliter la procédure d'emprunt engagée par Monsieur B.B., son fils. Il soutient qu'il n'a jamais porté une quelconque mention manuscrite sur ledit document, comme l'exige l'article 4, alinéa 2 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés, et qu'il n'a pas été destinataire d'une copie du contrat de cautionnement qui puisse lui permettre d'en prendre véritablement connaissance du contenu pour mesurer l'ampleur de son engagement.
Sur la validité de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur son immeuble, il soutient que le cautionnement étant, en son sens, nul, il justifie de motifs sérieux et légitimes pour en obtenir mainlevée sur la base de l'article 142, alinéa 1 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.
Décision du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso
Sur la validité du cautionnement
Le tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso observe tout d’abord que pour soutenir la nullité du cautionnement, Monsieur B.L. invoque entre autre la violation de l’alinéa 2 de l'article 4 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés, aux termes duquel le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature des deux parties et la mention écrite de la main de la caution, de la somme maximale garantie, en toute lettres et en chiffres.
Cependant, le contrat de cautionnement attaqué fait ressortir toutes les mentions concernées.
Le tribunal de grande instance observe ensuite que Monsieur B. L., qui ne conteste pas sa signature, n'apporte toutefois aucune preuve pour établir que la mention manuscrite concernant la somme maximale garantie n'émane pas de lui.
En outre, Monsieur B. L. invoque le fait qu'une copie du contrat ne lui aurait pas été remise pour mesurer l'ampleur de son engagement, mais il ne justifie pas que lui-même en aurait demandé une copie et qu'on lui aurait refusé.
Au demeurant, l'article 136 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés ne prévoit pas de sanction pour la violation des formalités concernées. Au sens de ce texte, ce qui est important dans le cautionnement c'est que les volontés des parties de s'engager soient clairement exprimées.
En l’espèce, le cautionnement attaqué présente cette garantie.
Par conséquent, le tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso considère qu’il y a lieu d’écarter le moyen invoqué comme étant inopérant.
Sur la validité de l’hypothèque judiciaire provisoire
Monsieur B.L. conclut que le cautionnement est nul et que cela constitue des motifs sérieux et légitimes pour fonder une mainlevée totale ou partielle de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur son immeuble, comme le prévoit l'article 142, alinéa 1 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.
Cependant, il est établi que le cautionnement a été valablement passé par les parties. Le défendeur ne justifie pas d'autres motifs qui puissent fonder ses prétentions.
Le tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso estime que ce second moyen tiré de l'existence de motifs légitimes et sérieux pour la mainlevée de l’hypothèque judiciaire est tout aussi inopérant et mérite rejet.
Sur le bien fondé de la demande
Le tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso rappelle que conformément à l'article 142, alinéa 1 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés, la juridiction saisie peut, en tout état de cause, avant même d'avoir statué sur le fond, ordonner une mainlevée totale ou partielle de l’hypothèque si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes.
En l’espèce, la caution n'a avancé aucun motif au sens du texte suscité de nature à justifier une mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire portant sur son immeuble. Il y a donc lieu de déclarer ladite bonne et valable.
Bon à savoir
Cette décision fait une application rigoureuse des règles relatives à la formation du contrat de cautionnement, telles que prévues sous l’égide de l’ancienne version de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés2.
Ces règles ont toutefois été assouplies par le nouvel Acte uniforme portant organisation des sûretés3. En effet, si la convention de cautionnement devait, sous peine de nullité, être conclue expressément entre le créancier et la caution et être formée par écrit, tel n’est plus le cas désormais. Le législateur OHADA a, par cet assouplissement entourant la constitution du cautionnement, mis fin aux controverses doctrinales sur la question du caractère formel ou consensuel du cautionnement4 en affirmant tacitement son caractère consensuel. Le consentement du créancier et celui de la caution suffisent en effet pour que le cautionnement soit valablement constitué. Si le consentement peut être tacite, la volonté des parties contractantes doit toutefois être établie avec certitude5. L’écrit demeure de facto l’unique mode de preuve6.
Conformément à l’article 14 AUS Révisé, l’écrit et la signature de la caution et du créancier ne constituent ainsi plus une condition de validité du cautionnement, mais uniquement une condition de preuve de ce dernier7.
En effet, l’article 14 précité dispose que le cautionnement ne se présume pas, peu importe la nature de l’obligation garantie. Il se prouve par un acte comportant la signature de la caution et du créancier ainsi que la mention, écrite de la main de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires. En cas de différence entre ces deux mentions, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres8.
Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.
_______________
1. Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Jugement n° 106 du 18 avril 2007, BANK OF AFRICA c/ BALIMA Lamoussa, Ohadata J-09-98, www.ohada.com
2. Y. R. KALIEU ELONGO, « Observations », sous Tribunal de Grande Instance du Mfoundi, Jugement n° 404/CIV du 28 mars 2005, PITAMBERT LADHARAM ASNANI contre Mme EPANE MBOUMDJA JULIENNE, Ohadata J-08-112, www.ohada.com. Voy. aussi du même auteur : Les sûretés personnelles dans l’espace OHADA, PUA, collection Vade Mecum 2006.
3. K. M. BROU, « Le nouvel Acte uniforme portant organisation des sûretés et l’accès au crédit dans l’espace OHADA », Ohadata D-13-23, pp. 5-6, www.ohada.com
4. Pour des partisans de la thèse formaliste, voy. notamment F. ANOUKAHA, « Le droit des sûretés dans l’Acte uniforme OHADA », PU d’Afrique, 1998, pp. 35 et s., A. SAKHO et I. N’DIAYE, « Pratique des garanties du crédit », Revue africaine de banque, 1998, pp. 17 et s. Pour des auteurs favorables à la thèse consensualiste, voy. F. ANOUKAHA, A. CISSE-NIANG, M. FOLI, J. ISSA-SAYEGH, I. YANKHOBA NDIAYE et M. SAMB, Ohada. Sûretés, coll. Droit uniforme africain, Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 14 et s.
5. H. D. AMBOULOU, Le droit des sûretés dans l’espace OHADA, Paris, L’Harmattan, 2014, p. 20.
6. L. BLACK YONDO et autres, Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés. La réforme du droit des sûretés de l’OHADA, coll. Lamy Axe Droit, Rueil-Malmaison Cedex, Lamy, 2014, pp. 78-80 ; Ph. SIMLER, Cautionnement et garanties autonomes, 3e éd., Paris, Litec, 2000, n°52.
7. Article 14 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
8. Y. KALIEU, « La mention manuscrite dans le cautionnement Ohada », Ohadata D-03-02, www.ohada.com