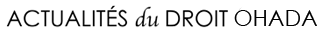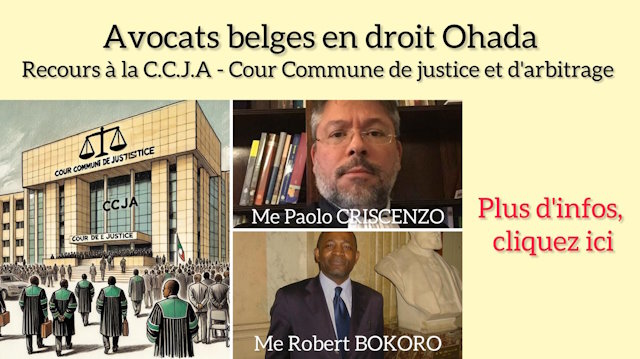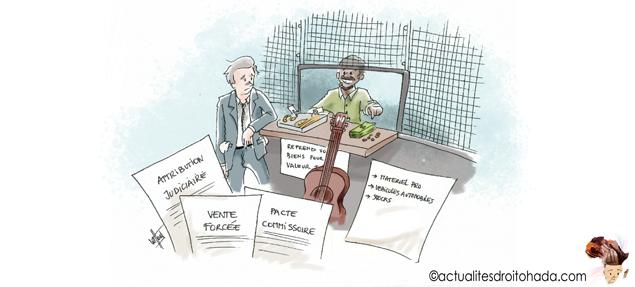
Le gage de meubles corporels
Effets du gage sur meubles corporels
L’analyse des effets du gage implique qu’il y a lieu de distinguer les dispositions communes aux gages de celles spécifiques au gage avec dépossession.
Abordons maintenant les dispositions spécifiques au gage avec dépossession. Elles concernent le droit de rétention et la revendication de la chose.
Si le gage avec dépossession et le gage sans dépossession constituent la même sûreté, la remise de la chose offre un avantage particulier au gage avec dépossession. Seul ce dernier consacre en effet un droit de rétention au créancier gagiste 23. Cela n’a rien d’étonnant, étant donné que la détention matérielle de la chose par le créancier est une condition essentielle à l’exercice d’un droit de rétention 24. Ce droit est indivisible 25.
En tout état de cause, ce droit de rétention ne peut être exercé que sous réserve de l’application de l’article 107, alinéa 2, lequel prévoit que lorsqu’un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l’objet d’un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu’il a été régulièrement publié et nonobstant le droit de rétention de ce dernier. Le droit de préférence du créancier antérieur fait échec au droit de rétention du créancier gagiste postérieur 26.
Toutefois, en cas de conflit avec un créancier gagiste antérieur sans dépossession, le droit de rétention du créancier postérieur sera paralysé et la préférence sera donnée au créancier le plus ancien, pour autant qu’il ait régulièrement publié son droit de gage, le rendant ainsi opposable aux tiers, dont notamment le créancier rétenteur postérieur.
En outre, le créancier gagiste avec dépossession bénéficie d’une protection supplémentaire : le droit de suite. En effet, tout créancier qui serait dessaisi contre sa volonté peut revendiquer la chose gagée comme un possesseur de bonne foi 27. Par contre, si le créancier perd la chose gagée, le gage s’éteint indépendamment de l’obligation garantie 28.
Passons maintenant à l’étude des dispositions communes aux gages avec et sans dépossession. Elles concernent les droits sur la chose gagée, l’obligation de conservation, ainsi que la réalisation du gage.
Concernant les droits sur la chose gagée, il y a lieu de distinguer l’usage de la chose gagée et sa jouissance.
Lorsqu’il est question d’un gage avec dépossession, le créancier gagiste ne peut pas, en principe, user du bien remis en gage 29, sauf autorisation expresse dans le contrat de gage 30. En cas de gage sans dépossession, le débiteur ou le tiers constituant resté en possession du bien peut continuer à en disposer. Les parties peuvent toutefois prévoir des limitations à l’utilisation du bien gagé par le constituant 31.
De même qu’il n’a pas en principe de droit d’usage sur la chose gagée, le créancier gagiste n’a pas non plus de droit aux fruits. Peu importe la forme du gage, c’est le constituant qui peut percevoir les fruits, sauf dérogation expresse. Dans ce dernier cas, le créancier gagiste devra imputer les fruits perçus en priorité sur les intérêts et, à défaut, sur le capital, pour que les fruits profitent au constituant en valeur 32.
Concernant l’obligation de conservation, il y a lieu de préciser que celle-ci pèse sur le créancier gagiste ou sur le constituant du gage, selon qu’il s’agit d’un gage avec ou sans dépossession.
Lorsque la chose gagée est remise entre les mains du créancier gagiste ou d’un tiers convenu, ceux-ci sont tenus d’une obligation de conservation, similaire à celle d’un dépositaire rémunéré 34. En cas de méconnaissance de cette obligation, le constituant sera en droit de demander la restitution du bien gagé ainsi que des dommages et intérêts 35.
Les frais déboursés par le créancier gagiste ou le tiers convenu seront remboursés par le constituant du gage, lors de la restitution du bien gagé, pour autant qu’ils constituent des impenses, c’est-à-dire des dépenses utiles et nécessaires à la conservation 36.
A contrario, lorsque le bien ne quitte pas les mains du constituant, celui-ci doit également conserver le bien en bon état, et notamment, l’assurer contre les risques de perte et de détérioration totale ou partielle 37. Si le constituant vient à manquer à son obligation de conservation, le créancier pourra soit se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie, soit demander un complètement de gage 38.
Enfin, quant à la réalisation du gage, l’article 104 de l’Acte uniforme énonce trois modes, à savoir la vente forcée, l’attribution judicaire et le pacte commissoire sous certaines conditions. Les deux premiers modes étaient déjà prévus par la précédente version de l’Acte uniforme, le troisième a été ajouté par la nouvelle version. Les parties peuvent toutefois convenir d’un autre mode de réalisation dès la conclusion du contrat de gage ou bien décider de laisser au créancier gagiste une option entre ces trois modes au moment de la réalisation du gage 39.
La vente forcée ne pourra être demandée par le créancier gagiste que si ce dernier dispose d’un titre exécutoire 40. Il devra alors adresser une mise en demeure au débiteur ou au tiers constituant, selon les cas, dans les conditions prévues par les dispositions organisant les voies d’exécution auxquelles le contrat de gage ne peut déroger 41. Cette limite proscrit le recours à l’usage de la clause de voie parée 42. Ce n’est que dans un délai de huit jours suivant la date de la mise en demeure que la vente forcée peut intervenir 43.
La vente forcée permet au créancier gagiste d’exercer son droit de préférence sur le prix de la chose versé par le tiers acquéreur, en tenant compte de l’ordre de paiement des créanciers pour la réalisation des meubles 44.
L’attribution judiciaire est réglementée par l’article 104, alinéa 2 de l’Acte uniforme, lequel prévoit que le créancier peut faire constater l’exigibilité de sa créance par la juridiction compétente et demander que le bien gagé lui sera attribué. Le bien gagé attribué au créancier gagiste est évalué sur la base des cours actuels ou par un expert désigné judiciairement 45.
Le pacte commissoire (appelé aussi l’attribution conventionnelle) est admis à titre de mode de réalisation différemment selon que le débiteur est un professionnel ou non 46. S’il est question d’un débiteur professionnel, le pacte commissoire est admis, peu importe la nature de la chose gagée. Dans le cas inverse, le pacte commissoire n’est admis que si le bien gagé est une somme d’argent ou un bien dont la valeur fait l’objet d’une cotation officielle. Le débiteur particulier, moins averti que le débiteur professionnel, est ainsi davantage protégé. En effet, lorsque le gage porte sur l’un de ces biens, le risque de spoliation est nul, dans la mesure où le bien fait l’objet d’une évaluation objective et certaine 47.
Aucune estimation n’est donc exigée pour un gage portant sur une somme d’argent ou un bien dont la valeur fait l’objet d’une cotation officiel, et dont le débiteur est un particulier 48. Par contre, pour le gage consenti en garantie des obligations d’un débiteur professionnel, une estimation sera requise lorsqu’il porte sur un bien autre qu’une somme d’argent ou un bien objet d’une cotation officielle. Dans ce cas, le bien fera l’objet d’une évaluation par un expert désigné à l’amiable ou par voie judiciaire. Cette estimation n’aura aucune incidence sur le transfert de propriété au créancier, qui aura lieu le jour du défaut de paiement ou à une toute autre date postérieure qui aurait été convenue. L’évaluation du bien se fera, quant à elle, à la date du transfert 49.
_______________
23. A. CISSE-NIANG, « Le gage », in OHADA. Sûretés, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 91.
24. Articles 67 et suivants de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés ; L.-J. LAISNEY, « Les gages de meubles corporels », in Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés. Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés. La réforme du droit des sûretés de l’OHADA, Rueil-Malmaison (France), Lamy, 2012, p. 206.
25. H. DIDACE AMBOULOU, Le droit des sûretés dans l’espace OHADA, Paris, L’Harmattan, 2014, p. 27.
26. Article 107, alinéa 2 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
27. Article 100 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés ; A. MARCEAU-COTTE et L.-J. LAISNEY, « Vers un nouveau droit du gage OHADA », Dr. & patr., 2010, n°197, p. 68 ; A. CISSE-NIANG, « Le gage », in OHADA. Sûretés, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 92.
28. Article 117 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
29. H. DIDACE AMBOULOU, Le droit des sûretés dans l’espace OHADA, Paris, L’Harmattan, 2014, p. 28.
30. Article 103 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
31. L.-J. LAISNEY, « Les gages de meubles corporels », in Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés. Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés. La réforme du droit des sûretés de l’OHADA, Rueil-Malmaison (France), Lamy, 2012, p. 207.
32. L. AYNES, « Le nouveau droit du gage », Dr & patr., 2007, n°161, p. 52 ; article 108, alinéa 2 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
33. A. CISSE-NIANG, « Le gage », in OHADA. Sûretés, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 95.
34. Article 108 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
35. Article 109 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés ; Y. KALIEU ELONGO, Droit et pratique des sûretés réelles. OHADA, Yaoundé (Cameroun), Presses universitaires d’Afrique, 2010, p. 95.
36. Article 113 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés ; H. DIDACE AMBOULOU, Le droit des sûretés dans l’espace OHADA, Paris, L’Harmattan, 2014, p. 28.
37. Article 103 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés ; A. MARCEAU-COTTE et L.-J. LAISNEY, « Vers un nouveau droit du gage OHADA », Dr. & patr., 2010, n°197, p. 70.
38. Article 109 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
39. Article 104 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
40. Tribunal régional hors classe de Dakar, 2 décembre 2003, jug. civ., n°1970, SFE c/ Madieng Dieng, Ohadata, n°J-04-265 ; Tribunal régional hors classe de Dakar, ord. Réf., 25 novembre 2002, la SFE c/ Ablaye Deme ; Tribunal régional hors classe de Dakar, 2 décembre 2003, jug. civ., n°1971, SFE ex SOGEGA c/ Sidy Samb.
41. Tribunal régional hors classe de Dakar, ord. réf., 25 novembre 2002, la SFE c/ Ablaye Deme ; CA Ouagadougou, ch. civ. et com., 16 juillet 2004, arrêt n°87, Société Burkinabè de Crédit Automobile (SOBCA) c/ Zongo K. Hamidou.
42. Le recours à la clause de voie parée demeure interdit dans le nouvel AUS. Cette clause ne doit pas être confondue avec le pacte commissoire. Contra : A. LO BA, Quelques réflexions sur le nouvel acte uniforme des sûretés : un vrai « dolly » juridique, www.ohada.com, lettre d’information du 31 août 2011.
43. Sur l’exigence d’une mise en demeure restée sans effet, voy. Tribunal régional hors classe de Dakar, ord. réf., 25 novembre 2002, la SFE c/ Ablaye Deme ; Tribunal régional hors classe de Dakar, 2 décembre 2003, jug. civ., n°1971, SFE ex SOGECA c/ Sidy Samb.
44. Article 104, alinéa 1er de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
45. Article 104, alinéa 2 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
46. A. MARCEAU-COTTE et L.-J. LAISNEY, « Vers un nouveau droit du gage OHADA », Dr. & patr., 2010, n°197, p. 69.
47. L.-J. LAISNEY, « Les gages de meubles corporels », in Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés. Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés. La réforme du droit des sûretés de l’OHADA, Rueil-Malmaison (France), Lamy, 2012, p. 218.
48. Au sujet d’un gage de titres, sous l’empire de la version précédente de l’Acte uniforme, voy. CA Abidjan, 9 juillet 2002, arrêt n°875, société Vansco Air Freight Import Export, John Marques Gabrielle Kakumba c/ Ecobak, SGBI et a.
49. L.-J. LAISNEY, « Les gages de meubles corporels », in Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés. Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés. La réforme du droit des sûretés de l’OHADA, Rueil-Malmaison (France), Lamy, 2012, p. 215.