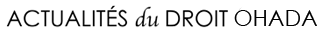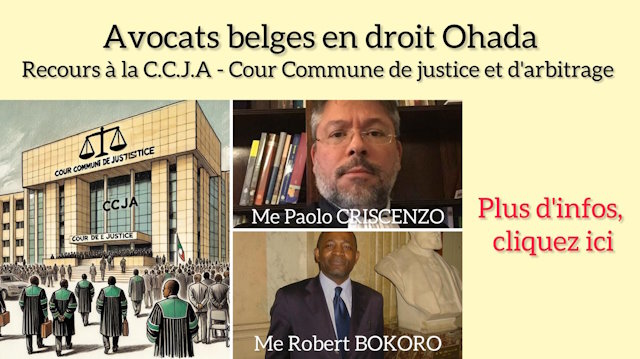La société en commandite simple
Fonctionnement de la societe en commandite simple
Comme dans les sociétés en nom collectif, il existe deux entités au sein de la société en commandite simple, à savoir, d’une part, les gérants qui assurent le fonctionnement quotidien de la société et, d’autre part, les associés de la société qui détiennent le pouvoir souverain.
Parlons, tout d’abord, des gérants de la société en commandite simple.
La société en commandite simple est gérée par tous les associés commandités, qui peuvent désigner dans les statuts un ou plusieurs gérants, parmi les associés commandités ou en prévoir la désignation dans un acte ultérieur aux statuts de la société. Ceux-ci sont désignés dans les mêmes conditions que celles prévues pour la société en nom collectif et disposent des mêmes pouvoirs que les associés en noms collectifs 22.
A contrario, les associés commanditaires ne peuvent être nommés gérants, et de manière plus générale, ne peuvent accomplir des actes de gestion externe, même en vertu d’une procuration 23. Ceux-ci ne sont, en d’autres termes, pas autorisés à intervenir dans la gestion externe de la société. Ils ne peuvent donc pas contracter des engagements pour le compte de la société, à défaut de quoi ils engageraient leur responsabilité sur l’ensemble de leurs biens, comme les associés commandités 24.
La règle portant prohibition de l’immixtion du commanditaire est destinée à assurer la protection des créanciers sociaux, qui ne doivent pas être soumis au risque d’être induits en erreur sur la situation de l’associé commanditaire qu’ils pourraient considérer comme étant un associé indéfiniment et solidairement tenu des dettes sociales 25.
Cette règle peut également être justifiée par une considération de fait : l’associé commanditaire, lorsqu’il participe de manière active dans la gestion externe de la société, se comporte comme un associé commandité, de sorte qu’il doit également assumer une responsabilité indéfinie et solidaire 26.
En fonction du nombre et de la gravité des actes, les associés commanditaires peuvent, en effet, être obligés pour tous les engagements de la société ou pour quelques-uns seulement 27.
Toutefois, le législateur OHADA précise que les avis et conseils, ainsi que les actes de contrôle et de surveillance n'engagent pas la responsabilité des associés commanditaires à l’égard des tiers 28. Les associés commanditaires peuvent donc participer à la gestion interne de la société.
Pour le surplus, il y a lieu d’appliquer les règles applicables à la nomination et au pouvoir des gérants de la société en nom collectif 29.
S’agissant des pouvoirs et des responsabilités du ou des gérants, il convient de les examiner, d’une part, dans les relations entre associés et, d’autre part, dans les rapports vis-à-vis des tiers.
Dans la première hypothèse, le ou les gérants doivent respecter des obligations identiques à celles du mandataire. En effet, ils doivent agir dans l’intérêt de la société et consacrer toute leur activité aux affaires sociales. Le montant de leur rémunération est déterminé à la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires. En outre, ils sont indemnisés, lorsqu’ils sont révoqués sans juste motif.
Dans le second cas, le ou les gérants ont des pouvoirs extrêmement étendus à l’égard des tiers. Précisons, à cet égard, que les limitations aux pouvoirs des gérants ne leur sont pas rendus opposables.
Par ailleurs, l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique ne prévoit aucune disposition propre à la révocation du gérant. Il ne renvoie pas non plus aux dispositions applicables à la fin des fonctions du gérant dans la société en nom collectif. Par conséquent, il faut s’en remettre à ce qui a été prévu dans les statuts de la société en commandite simple. A défaut, il y aura lieu d’appliquer les articles 302 à 305 de l’Acte uniforme, lesquels prévoient les modalités de prise de décisions collectives 30.
Parlons maintenant des associés de la société en commandite simple.
Cette forme de société a la particularité de regrouper deux catégories d’associés : les associés commandités et les associés commanditaires. C’est en ceci qu’elle se distingue de la société en nom collectif.
Les associés commandités ont plus d’obligations que les commanditaires, en raison de leur responsabilité plus grande. Corrélativement, ils disposent de droits plus étendus. En effet, il est interdit aux commanditaires de s’occuper de la gestion externe de la société.
A côté de cette interdiction d’immixtion du commanditaire, les commandités et les commanditaires disposent de droits assez semblables, à savoir le droit de participer aux bénéfices et le droit de prendre part aux décisions collectives 31.
Les statuts prévoient les modalités de prise de décisions par la collectivité des associés quant aux modalités de consultation, en assemblée ou par consultation écrite, aux quorums, et aux majorités 32. Une grande liberté est ainsi offerte aux associés, lesquels pourront opter pour la réunion en assemblée ou la consultation par correspondance 33.
Le législateur OHADA apporte toutefois deux limites à la liberté des associés.
Premièrement, la réunion d’une assemblée est de droit si elle est demandée soit par un associé commandité, soit par le quart en nombre et en capital des associés commanditaire 34.
Deuxièmement, il est tenu chaque année, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, une assemblée générale annuelle au cours de laquelle le rapport de gestion, l'inventaire et les états financiers de synthèse établis par les gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés 35. La tenue de cette assemblée générale annuelle requiert la réunion de la majorité des associés représentant au moins la moitié du capital social. L’accord unanime de tous les associés commandités ainsi que la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires sont également requis 36.
Lorsque les décisions sont prises à l’assemblée générale, le ou les gérants sont tenus de la convoquer au moins quinze jours avant sa tenue, par lettre au porteur contre récépissé ou par courrier commandé avec réception. Les associés peuvent également être convoqués aux assemblées par voie électronique 37.
La date, le lieu de la réunion et l’ordre du jour doivent être mentionnés dans la convocation. Toute assemblée convoquée irrégulièrement peut être annulée. L’action en nullité n’est toutefois pas recevable lorsque tous les associés sont présents ou représentés 38.
Dans l’hypothèse d’une consultation par correspondance, il en fait mention dans le procès-verbal, signé par le ou les gérants et auquel est joint la réponse de chacun des associés.
En outre, les associés commanditaires et commandités non gérants ont le droit d’obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la situation sociale auxquelles le ou les gérants répondront par écrit 39.
Par ailleurs, les commandités et les commanditaires ont les mêmes obligations quant à la contribution au passif social. Celle-ci est proportionnelle au nombre de parts détenues par chacun des associés, sauf si les statuts prévoient le contraire.
La qualité d’associé commandité ou d’associé commanditaire n’intervient que pour la détermination du degré de responsabilité 40.
Les associés commandités répondent indéfiniment et solidairement du passif social.
Les commanditaires, quant à eux, sont tenus des dettes contractées par la société dans la limite de leurs apports. Toutefois, il peut arriver qu’ils soient responsables des dettes sociales sur leur patrimoine personnel. Il en va ainsi lorsqu’ils interviennent dans la gestion externe de la société 41 ou lorsque le nom d’un commanditaire est incorporé à la dénomination sociale 42.
____________________
22. Article 298 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
23. Article 299 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
24. A. Fénéon, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 758 ; D. Ndiaw, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 355.
25. D. Ndiaw, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 355.
26. B. Le Bars, Droit des sociétés et de l’arbitrage international. Pratique en droit de l’Ohada, Joly, Paris, 2011, p. 256.
27. Article 300 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
28. Article 301 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
29. A. Fénéon, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 758.
30. A. Fénéon, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 762.
31. D. Ndiaw, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 358.
32. Article 302, al. 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
33. D. Ndiaw, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 358.
34. Article 302, al. 3de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
35. Article 306 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
36. A. Fénéon, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 760.
37. Ibid.
38. D. Ndiaw, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 359.
39. A. Fénéon, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), LGDJ, 2015, p. 760.
40. D. Ndiaw, « Les sociétés de personnes », in Sociétés commerciales et G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 360.
41. Article 299 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
42. Article 294, al. 2 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.