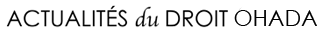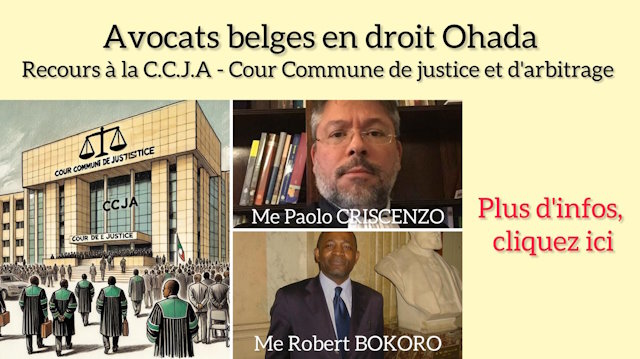Le nantissement de meubles incorporels
Le nantissement de creance
La constitution du nantissement de créance requiert la réunion de plusieurs conditions. Par souci méthodologique, nous les classerons en trois groupes : les conditions de fond, les conditions de forme et les conditions d’opposabilité.
Le nantissement de créance, pour être valablement constitué, sera tout d’abord soumis à des conditions de fond. Celles-ci ont trait à la créance nantie et à la créance garantie.
Le nantissement de créance porte sur une ou plusieurs 5 créances, actuelles ou futures 6. L’abandon de la remise de la chose comme condition de validité du nantissement permet en effet la constitution de nantissements portant sur des créances futures 7. Par « créance future », il y a lieu d’entendre les créances déjà nées mais à terme et les créances à naître, c’est-à-dire résultant d’un acte ou d’un fait juridique non encore survenu.
Aucune exigence n’est requise quant à la nature de la ou des créances nanties. En effet, toutes les créances peuvent être nanties : elles peuvent être contractuelles ou délictuelles, civiles ou commerciales et même d’origine étrangère.
Il en de même pour les créances garanties. La qualité du créancier ou du débiteur n’a pas d’importance. Par ailleurs, les créances garanties peuvent également être futures, à condition toutefois qu’elles soient déterminées ou, à tout le moins, déterminables.
Outre ces conditions de fond, le nantissement de créance requiert, à peine de nullité, la rédaction d’un écrit. Cet écrit peut tantôt être conclu sous seing privé ou par acte authentique, auquel cas il aura date certaine. Il doit, en outre, décrire la (les) créance(s) garantie(s), de même que celle(s) nantie(s), ou, si elles sont futures, les éléments de nature à permettre leur individualisation, comme l’indication du débiteur, le lieu du paiement, le montant des créances ou leur évaluation et leur échéance 8.
Enfin, le nantissement sur créance doit respecter, comme toutes les sûretés réelles, des conditions d’opposabilité, qui auront pour but d’informer les tiers de l’existence des sûretés, afin que le créancier puisse leur opposer son droit. Il y a lieu, à cet égard, de distinguer les formalités d’opposabilité accomplies d’une part à l’égard du débiteur de la créance nantie et, d’autre part, à l’égard des autres tiers 9.
A l’égard du débiteur de la créance nantie, l’accomplissement des formalités d’opposabilité permettent de s’assurer que le débiteur a une connaissance certaine et réelle de l’existence du nantissement. Pour que le nantissement lui soit opposable, le débiteur devra recevoir une notification de l’acte ou devra y intervenir. Une notification intervenue par simple lettre suffit 10.
Toutefois, il y a lieu de préciser à cet égard qu’en l’absence de notification, le nantissement demeure valable entre parties. En effet, il ne vaut plus, comme par le passé, une simple promesse de nantissement 11. Dans ce dernier cas, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance, à charge pour lui d’en verser le montant au créancier nanti, sauf clause contraire et moyennant le respect des dispositions de l’article 134 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés 12.
Après notification ou intervention à l’acte du débiteur de la créance nantie, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de cette créance tant en capital qu’en intérêts et autres accessoires, même lorsque celui-ci n’en a pas poursuivi le paiement 13.
A l’égard des autres tiers créanciers du constituant, le nantissement leur est rendu opposable à dater de son inscription au RCCM, conformément aux modalités régies par le droit commun des inscriptions des suretés mobilières au RCCM 14.
Les effets du nantissement de créance se sont écartés du schéma classique du droit de préférence exercé par le créancier bénéficiaire d’une sûreté réelle sur le prix de vente du bien grevé par ladite grevée. Cela s’explique en raison du particularisme du nantissement de créance. Ce dernier est en effet construit autour du principe selon lequel dès le moment où il est notifié au débiteur de la créance nantie, seul le créancier reçoit valablement paiement de la créance nantie et peut imputer le montant payé au titre de la créance nantie sur le solde de la créance garantie, qui doit être échue 15.
Le nouvel Acte uniforme portant organisation des sûretés distingue à cet égard deux situations.
La première hypothèse est celle où la créance nantie vient à échéance avant la créance garantie. Le créancier ne peut s’approprier les sommes reçues du débiteur, dans la mesure où cette appropriation vaudrait paiement de la créance garantie, alors même qu’elle n’est pas encore exigible. Dans ce cas, l’article 134 dudit Acte dispose que le créancier nanti conserve les sommes à titre de garantie sur un compte ouvert 16 auprès d’un établissement habilité à recevoir, à charge pour lui de les restituer au constituant si l’obligation garantie est exécutée 17. Le nantissement de créance initial se transforme alors en en une sûreté-propriété sur une somme d’argent 18.
La deuxième hypothèse vise la situation où la créance garantie arrive à échéance avant la créance nantie. Le créancier nanti dispose alors d’une option. Il peut se faire attribuer la créance, soit par attribution judiciaire, soit par l’effet d’un pacte commissoire. Le créancier nanti peut également attendre l’échéance de la créance nantie. Pour recevoir le paiement de la créance nantie, il devra au préalable avoir pris soin de notifier le nantissement 19.
Sauf stipulation contraire, le créancier nanti perçoit, en outre, les intérêts en les imputant sur la créance qui lui est due en capital, intérêts et autres accessoires 20.
Enfin, si le créancier nanti reçoit une somme supérieure à la dette garantie, il doit répondre du surplus perçu en qualité de mandataire du constituant. A cet égard, toute clause qui prévoirait le contraire est réputée non écrite 21.
_______________
5. Cet élargissement de l’assiette ouvre ainsi la voie au nantissement d’un nombre illimité de créances, à condition que ces créances soient identifiables.
6. Article 92 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
7. Articles 125, 127, 128 et 131 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
8. Article 127 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
9. Article 131 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
10. Article 132, alinéa 1er de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
11. Cette précision est importante en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’égard du constituant. La date à prendre en compte pour apprécier si le nantissement a été conclu en période suspecte est la date du nantissement, peu importe que la notification ait été postérieure. En droit français, avant la réforme de 2006, il fallait prendre en compte la date de signification, mais la signification était considéré comme une condition de validité et non d’opposabilité (Cass. com., 28 janvier 1997, n°94-20.554, Bull. civ., IV, 1997, n°35, RTD civ., 1998, p. 705, obs. P. CROCQ).
12. Article 132, alinéa 2 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
13. Article 133 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
14. O. FILLE LAMBIER, « Le nantissement de créance », in Le nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés, Rueil-Malmaison (France), Ed. Lamy, 2012, p. 232.
15. Ibid., p. 233.
16. La disposition ne précise pas s’il s’agit d’un compte spécial ou d’un compte bloqué.
17. Article 134, alinéa 1er de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
18. M. CABRILLAC, S. CABRILLAC, Ch. MOULY et Ph. PETEL, Droit des sûretés, 9ème éd., Paris, Litec, 2010, n°767.
19. Article 134, alinéa 2 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
20. Article 134, alinéa 3 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
21. Article 135 de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.